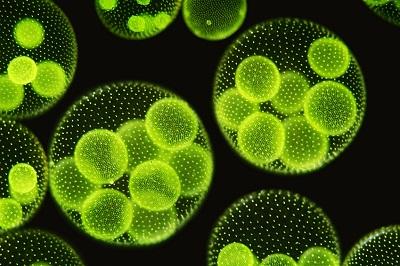Le rôle du captage et stockage de carbone dans la décarbonation de l’industrie

Le captage et stockage du CO2 : Un levier crucial pour la décarbonation de l’industrie
Le captage et stockage du dioxyde de carbone (CO2) (CCS, pour Carbon Capture and Storage) est devenu un élément central des stratégies climatiques mondiales. Le CCS permet de capturer le CO2 émis par les industries lourdes ayant recours aux énergies fossiles, avant de le transporter et de le stocker de manière sécurisée dans des formations géologiques profondes. À l’échelle mondiale, le CCS pourrait théoriquement réduire d’environ 15 % les émissions de CO2 pour atteindre les objectifs climatiques de l’accord de Paris[1]. Dans l’UE, l’objectif est d’atteindre 280 millions de tonnes de CO2 captées par an d’ici 2040 et 450 millions d’ici 2050[2]. Cependant, la technologie, bien qu’efficace, reste encore confrontée à de nombreux défis.
Le rôle du CCS dans les objectifs climatiques de l’UE
L’Union Européenne s’est fixé l’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 [3], et le CCS est un des moyens par lesquels cela peut être réalisé. Le secteur de l’industrie lourde, qui est à l’origine d’une part importante des émissions industrielles mondiales, ne pourra pas être entièrement décarboné via l’électrification des procédés ou l’utilisation d’hydrogène vert. Les émissions résiduelles de CO2, difficiles à éliminer, peuvent être traitées via des technologies de CCS. A titre d’exemple, en 2021, l’industrie du ciment a produit environ 2,2 milliards de tonnes de CO2 dans le monde[4], une émission difficile à compenser avec des solutions alternatives.
Captage en pré-combustion et post-combustion : Techniques et défis
Le captage en pré-combustion et post-combustion sont deux des méthodes principales utilisées pour capter le CO2. Le captage en pré-combustion, utilisé principalement dans des installations produisant de l’hydrogène ou du gaz de synthèse, permet d’extraire jusqu’à 90% du CO2 produit avant la combustion. Cependant, cette technologie est coûteuse et nécessite une infrastructure spécifique. Par exemple, le projet Porthos[5] aux Pays-Bas est une initiative européenne qui vise à capturer le CO2 provenant de la raffinerie de Rotterdam et d’autres sites industriels voisins, avant de le transporter et de le stocker sous la mer du Nord. Ce projet, d’un coût estimé à 2 milliards d’euros, pourrait capturer 2 à 5 millions de tonnes de CO2 par an, contribuant ainsi de manière significative à la décarbonation de l’industrie européenne. Le captage post-combustion, plus courant, est utilisé dans des installations classiques telles que les centrales thermiques. Dans cette approche, le CO2 est capté directement dans les gaz de combustion. Bien qu’efficace, cette méthode peut être énergivore, représentant entre 20% et 30% de la production d’énergie de l’usine pour séparer et comprimer le CO2.
Liquéfaction et transport du CO2 capté
Une fois capté, le CO2 doit être transporté vers des sites de stockage. Pour cela, il est souvent liquéfié, car cette technique réduit son volume de manière significative. Une grande partie du CO2 capté est transporté par pipelines. Le transport par pipeline présente cependant des défis : les pipelines de CO2 doivent être construits spécifiquement pour résister à des pressions élevées, pour minimiser les risques d’accidents. Le transport maritime est une alternative pour les zones géographiques isolées ; ainsi, des projets visent à connecter les sites industriels au stockage sous-marin. Le projet Northern Lights, développé en Norvège par Equinor, Shell et TotalEnergies, est un exemple emblématique de cette approche. Il prévoit le transport maritime de CO₂ liquéfié depuis des sites industriels européens vers un site de stockage géologique sous-marin dans la mer du Nord. Sa première phase, permettra de stocker 1,5 million de tonnes de CO₂/an, avec une capacité pouvant atteindre 5 Mt/an à terme.
Enjeux techniques et perception sociétale du stockage de CO2
Le stockage géologique du CO₂ constitue la dernière étape du processus. Il peut être effectué dans divers types de formations géologiques, telles que les bassins sédimentaires, les formations salines, les gisements gaziers épuisés, ou encore par minéralisation dans le basalte. Plusieurs sites de stockage existent et/ou sont en développement. Le plus grand projet de stockage de CO2 au monde est Sleipner, situé dans la mer du Nord, qui a stocké environ 20 millions de tonnes de CO2 depuis 1996[6]. Cependant, la perception sociétale du stockage du CO2 est encore marquée par des craintes, différents projets de sites de stockage ont été abandonnés à la suite de protestations locales. La perspective de stocker des milliers de tonnes de CO2 sous terre suscite des préoccupations concernant les risques de fuites, ou encore les impacts à long terme. Des activités de surveillance (ex-ante, lors de la sélection du site de stockage, et ex-post, jusqu’à la fermeture et post-exploitation du site) et modélisation prédictive doivent permettre de s’assurer de l’ensemble des garanties de sécurité (notamment la présence d’une roche couverture étanche et la stabilité géologique de la zone).
Freins sociétaux, techniques et politiques au déploiement du CCS à grande échelle L’un des principaux obstacles au déploiement du CCS à grande échelle est son coût élevé. Le captage du CO2 représente souvent entre 60% et 70% du coût total d’un projet CCS, avec des estimations qui varient selon les technologies et les sites. Par exemple, le coût de captage pour une centrale thermique classique pourrait être autour de 50 à 100 €/tonne de CO2 capté, et même 80 à 120 €/tonne pour une usine de ciment. De plus, les infrastructures de transport et de stockage représentent également des investissements considérables. Bien que des mécanismes comme le Marché de Crédits de Carbone aient été mis en place, il manque encore un cadre financier stable et incitatif pour faire face à ces coûts. L’enjeu de la perception sociétale est également fondamental : si la technologie est perçue comme un palliatif à la réduction des émissions, plutôt qu’une solution complémentaire, cela peut freiner les investissements et l’engagement public. En France, un état des lieux et perspectives du déploiement du CCUS a été publié par le Ministère de l’Economie en juillet 2024[7]. La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a mis en place un groupe de travail pour étudier les enjeux de déploiement du CCUS[8]. 11 recommandations ont été formulées lors de cette même année, parmi lesquelles la construction et la promotion de l’acceptabilité sociale des projets, la planification et le déploiement des chaînes de CCUS sur le territoire nationale, l’instauration d’une régulation souple des chaînes de valeur de CCUS, le soutien des investissements nécessaires au déploiements des chaînes de CCUS et l’anticipation des risques économiques et techniques liés au déploiement du CCUS.
[1] https://www.iea.org/reports/ccus-in-clean-energy-transitions/ccus-in-the-transition-to-net-zero-emissions
[2] https://lejournal.cnrs.fr/articles/co2-faut-il-capter-pour-decarboner
[3] https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_en
[4] https://lactualite.com/actualites/ciment-les-emissions-de-co2-ont-double-en-20-ans/
[5] https://www.porthosco2.nl/en/first-co2-storage-project-in-the-netherlands-is-launched/?utm_source=chatgpt.com
[6] https://www.equinor.com/news/20240404-reducing-emissions-from-sleipner-and-gudrun
[7] https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/Actualites/2024/etat-des-lieux-et-perspectives-de-deploiement-du-ccus-en-france.pdf
[8] https://www.cre.fr/actualites/toute-lactualite/la-cre-publie-son-rapport-de-prospective-sur-le-captage-le-transport-le-stockage-et-la-valorisation-du-co2.html
Plus d'actualités Newsletter